|
|
|
Une
Aventure Humaine
Soyez un Radioamateur
Actif
ou un RadioActif
|
Recherche
Scientifique, Expérimentation, Évolution des Sciences
Technologiques |
|
Électricité,
Électronique, Radioélectricité, Informatique,
Technologie, Composants |
|
Communications, Relations Humaines, Déontologie des Radioamateurs |
|
Courtoisie, Respect des autres, Bénévolat, Ouverture
d'Esprit, |
|
Enseignement des Connaissances acquises par les anciens
et le savoir de haute technicité des Jeunes. |
|
Connaissances :
Géographie,
Histoire de la Radio,
Langues Étrangères |
|
Garantie
d'une Exploitation de Stations Radioamateurs par un
trafic exemplaire |
|
conforme
à la réglementation en vigueur, |
|
Prévisions de Propagation Ionosphérique.
La
Propagation par voie Ionosphérique
L'ionosphère est une région de la haute
atmosphère terrestre, comprise entre environ
50 km et 1000 km
d'altitude, dont les constituants sont
partiellement ionisés sous l'influence des
radiations solaires. L'ionosphère est stratifiée
en couches superposées. Les couches les plus
ionisées sont situées entre
250 km et 400 km
d'altitude environ et forment la région
F
dont l'ionisation se maintient de nuit. On
trouve ensuite, par altitudes décroissantes, la
couche
E
régulière, présente uniquement de jour vers
90 à 130 km
d'altitude, les couches
Es
(E sporadiques) vers
100 km, puis la
couche
D
entre 50 km et 90 km.
La présence de particules ionisées dans
l'ionosphère confère à cette dernière la
particularité de réfracter les Ondes Radioélectriques qui s'y propagent. Les rayons
électromagnétiques sont ainsi courbés lors de
leur propagation au sein du milieu
ionosphérique. Pour les ondes de la gamme
décamétrique (fréquences comprises entre
3 MHz
et 30 MHz), les rayons peuvent, dans certaines
conditions, être renvoyés au sol, permettant
ainsi une propagation au-delà de l'horizon
optique. Ces rayons sont ensuite
réfléchis par le sol et peuvent
retourner dans l'ionosphère où le même processus
peut se dérouler de nouveau. Il en résulte une
propagation par bonds multiples sur des
distances pouvant atteindre plusieurs milliers
de kilomètres. D'un point de vue pratique,
seules les couches des régions
F
et E de
l'ionosphère participent à la réfraction des
ondes décamétriques. La couche
D, trop
faiblement ionisée, absorbe l'énergie de l'onde,
provoquant une atténuation du signal.
Une onde émise selon un angle d'élévation
fixé pénètre d'autant plus les couches
ionosphériques que sa fréquence est élevée.
Au-delà d'une certaine fréquence, l'onde
traverse l'ionosphère et se perd dans l'espace.
Il existe donc une limite supérieure de
fréquence, imposée par la réfraction
ionosphérique, au-dessus de laquelle la liaison
n'est plus possible. Cette limite est dénommée
MUF (Maximum Usable Frequency). C'est la
fréquence la plus élevée qui permet à un moment
donné d'assurer une liaison radioélectrique par
voie ionosphérique entre deux points donnés. Une
limite inférieure dénommée
LUF (Lowest Usable
Frequency) est imposée par la nécessité de
disposer d'un champ suffisant à la réception.
Une liaison utilisant la voie ionosphérique ne
peut donc être exploitée que dans une bande de
fréquence entre la LUF et la
MUF.
Le milieu de propagation ionosphérique
présente une grande variabilité, tant spatiale
(zones aurorales, zone équatoriale,...) que
temporelle (cycle diurne,
cycle de 11 ans,...).
Il en résulte que la planification, la mise en
service et l'exploitation de liaisons par voie
ionosphérique nécessitent généralement l'emploi
de prévisions de propagation. Étant donné les
fluctuations importantes des conditions de
propagation, ces prévisions se présentent sous
forme statistique. Ainsi le calcul des
caractéristiques de la propagation prévues sur
une liaison donnée se fera, par exemple, pour un
niveau de probabilité déterminé.
Si l'on s'intéresse par exemple, au seuil de
probabilité 90%, on définira pour une heure
donnée la MUF 90% et la
LUF 90% telles que la
bande de fréquences entre ces 2 valeurs
corresponde à une probabilité d'établissement de
liaison d'au moins 90%.
| |
|
|
Schéma
des couches de la Ionosphère |
|
| Lune =Nuit |
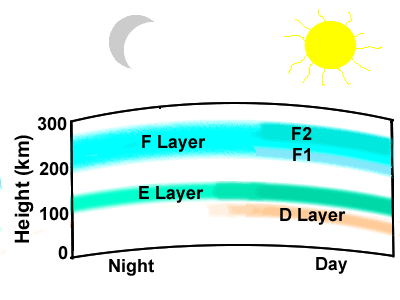 |
Soleil = Jour |
| |
| Hauteur en Km |
|
Couche = Layer |
| |
| |
Nuit = Night |
Jour = Day |
|
| |
|
Couche |
Altitude approximative
|
Importance
|
Présence
|
|
F
|
140 Km à 400 Km
|
Région principale de
« réflexion »
|
Permanente
(Plus fort pendant la journée)
|
|
E
|
90 Km à 140 Km
|
Région de « réflexion »
de plus basse fréquence
|
(Mais très faible la nuit°
|
|
D
|
50 Km à 90 Km
|
Région principale d'absorption
|
Journée seulement
|
|
|
|
La prévision
des conditions de Propagation
Principes de la méthode
:
La prévision de l'état futur des conditions
de propagation est basée sur des analyses
statistiques des caractéristiques de
l'ionosphère, mesurées à l'aide d'ionosondes
verticales en divers points du globe. Il ressort
de ces analyses que les valeurs médianes
mensuelles (pour un mois, une heure et un lieu
donnés) des principales caractéristiques de
l'ionosphère sont statistiquement corrélées à un
paramètre externe unique qui est l'indice
d'activité solaire. Cet indice rend compte de
l'état d'activité du soleil et résulte
d'observations quotidiennes de la surface
solaire.
Il est donc en principe possible de
déterminer à l'avance les caractéristiques
médianes de l'ionosphère à partir d'une
prévision de la valeur de l'indice solaire pour
cette période. L'indice d'activité solaire
utilisé dans les logiciels de prévisions de
propagation ionosphérique est
l'indice IR5 dont une prévision est
établie et diffusée mensuellement par le CNET
pour les 6 mois à venir.
Détermination de la MUF:
La prévision de propagation pour une liaison
donnée est obtenue à partir d'une modélisation
de la trajectoire des rayons électromagnétiques
entre l'émetteur et le récepteur. On considère
des trajets par bonds entre les couches
ionosphériques principales des régions
E
et
F et
le sol. La géométrie de ces trajets détermine
les modes de propagation possibles. A partir des
modèles de prévision des caractéristiques
ionosphériques, est calculée la fréquence
maximale utilisable pour chacun des modes de
propagation considérés. La
MUF correspond à la
plus grande de ces fréquences.
Détermination de la LUF :
Connaissant les modes de propagation
susceptibles d'exister, il faut aussi calculer
les limites inférieures de la bande de
fréquences utilisables pour chacun de ces modes
à partir de l'affaiblissement total du signal
sur le trajet. Cet affaiblissement comprend
entre autres l'affaiblissement spatial dû à la
dispersion du flux radioélectrique émis, les
pertes par absorption ionosphérique engendrées
par les traversées de la couche
D, les pertes
par réflexion sur le sol lorsque le mode
considéré implique plusieurs bonds ainsi que
quelques atténuations plus spécifiques
(atténuation aurorale et pertes dues à la
réflexion).
La fréquence minimale utilisable pour un mode
donné se ramène au calcul de la fréquence pour
laquelle l'affaiblissement de propagation de
l'onde est égal à l'affaiblissement maximal
toléré, déterminé à partir des performances des
équipements utilisés et du bruit radioélectrique
à la réception. La LUF
est la plus petite des
fréquences minimales utilisables pour chacun des
différents modes considérés.
|
|
|
LIGNE GRISE
La visualisation de la
fameuse "LIGNE GRISE" est la
séparation d'une zone de la terre encore éclairée par
le soleil, et sa voisine qui est déjà dans la pénombre.
Le couloir de cette ligne grise est généré par
le soleil, lorsque sa position passe en dessous
de 12 degrés au-dessus de l'horizon. Dans ce
couloir de ligne grise, les ions basse
d'altitude, ions qui dégrade le signal, sont
rapidement perdus, mais les ions de haute
altitude, qui reflètent le signal, sont toujours
très abondants. Ils sont en particulier
favorables à la propagation des Ondes Courtes.
|
|
|
La M.U.F
La carte avec
les courbes de niveau
de la fréquence maximum utilisable (MUF)
(la mise à jour s'effectue toutes les 30 minutes). La valeur de
la fréquence est à lire à mi-chemin (1500 kms).
La carte du monde avec courbes de niveau donne
la fréquence la plus haute qui se réfléchira sur
la couche d'ionisation de la Terre pour une
distance de 3000 kilomètres. Lire la valeur de M.U.F à mi-chemin du parcours (1500 kilomètres).
Les fréquences plus hautes se perdront dans
l'espace. Fait voir aussi l'emplacement actuel
de l'Ovale Auroral. Les signaux réfléchis
par l'ovale seront probablement très dégradés.
La zone de lever/coucher du soleil donne les
régions où le soleil est en dessous de 12 degrés
au-dessous de l'horizon, ce couloir est appelé
ligne grise. Dans ce
couloir de ligne grise, les ions basse
d'altitude, ions qui dégrade le signal, sont
rapidement perdus, mais les ions de haute
altitude, qui reflètent le signal, sont toujours
très
abondants. Ils sont en particulier favorables à
la propagation des Ondes Courtes.
|
|
COUCHE E Hauteur
La carte et
les courbes de niveau globale mondiale, donne le maximum de
hauteur de la couche F2
(hmF2) se trouve à des kilomètres au-dessus de
la surface de la Terre. Faire voir aussi
l'emplacement actuel de l'Ovale l'Auroral, la
zone du lever de
soleil/coucher du soleil (Terminator) et les
régions où le soleil est moins de 12 degrés
au-dessous de l'horizon, ce couloir est appelé
ligne grise.
Dans ce
couloir de ligne grise, les ions basse
d'altitude, ions qui dégrade le signal, sont
rapidement perdus, mais les ions de haute
altitude, qui reflètent le signal, sont toujours
très
abondants. Ils sont en particulier favorables à
la propagation des Ondes Courtes. Plus le
sommet de la couche l'altitude F2 est haut, plus le signal radio
est éloigné, il sera capable de se
propager. |
|
|
COUCHE E
La mise à jour
se fait toutes
les minutes sur les sites concernés.
NB : L'image
risque de ne pas apparaître en cas d'obstruction des couches nuageuses. |
| |
|
|
L'OVALE
AURORAL
Structures
permanentes, les ovales auroraux terrestres ne
peuvent être vus dans leur totalité par un seul
observateur que depuis l'espace, comme le montre
la photo réalisée dans l'UV par le satellite en
orbite polaire Dynamic Explorer (NASA). Les
ovales auroraux sont presque constamment
observables, mais leur lueur est due à des
aurores diffuses, faibles, peu remarquables
depuis le sol.
Lors des sous-orages, des aurores brillantes
(qualifiées de discrètes, non pas parce qu’elles
sont peu remarquables –bien au contraire, mais
parce qu’on peut les compter) illuminent plus
intensément certaines parties de l’ovale auroral
(surtout du coté « nuit »).
Les particules à l’origine des aurores
brillantes dans les ovales (un autour de chaque
pôle magnétique) proviennent du feuillet de
plasma équatorial, une région de la queue de la
magnétosphère. Ces particules, depuis la queue
de la magnétosphère, suivent un chemin le long
des lignes de champ magnétique, là ou s’écoulent
des courants électriques alignés. Entraînées
dans ces courants, les particules du feuillet de
plasma précipitent dans l'ovale auroral qui
n'est autre que la projection dans la haute
atmosphère (vers 110 km environ) de la coquille
magnétique qui contient le feuillet.
L'ovale auroral est centré sur chaque pôle
magnétique. La latitude idéale pour observer les
aurores correspond au lieu où se projettent dans
la haute atmosphère de la Terre, les lignes de
champ connectées au feuillet de plasma:
typiquement 60 à 75 degrés de latitude
magnétique. |
| |
|
 |
|
L'ovale auroral terrestre sud au dessus de
l'Antarctique vu dans l'ultraviolet (130 nm) par
le satellite en orbite polaire Dynamic
Explorer. Les continents sont représentés en
vert. L'arc auroral transpolaire au centre de
l'ovale qui apparaît quelquefois permet de
qualifier cette configuration d'aurore théta
Source : Observatoire de Paris-Lésia :
http://www.lesia.obspm.fr/index.html
|
|
|